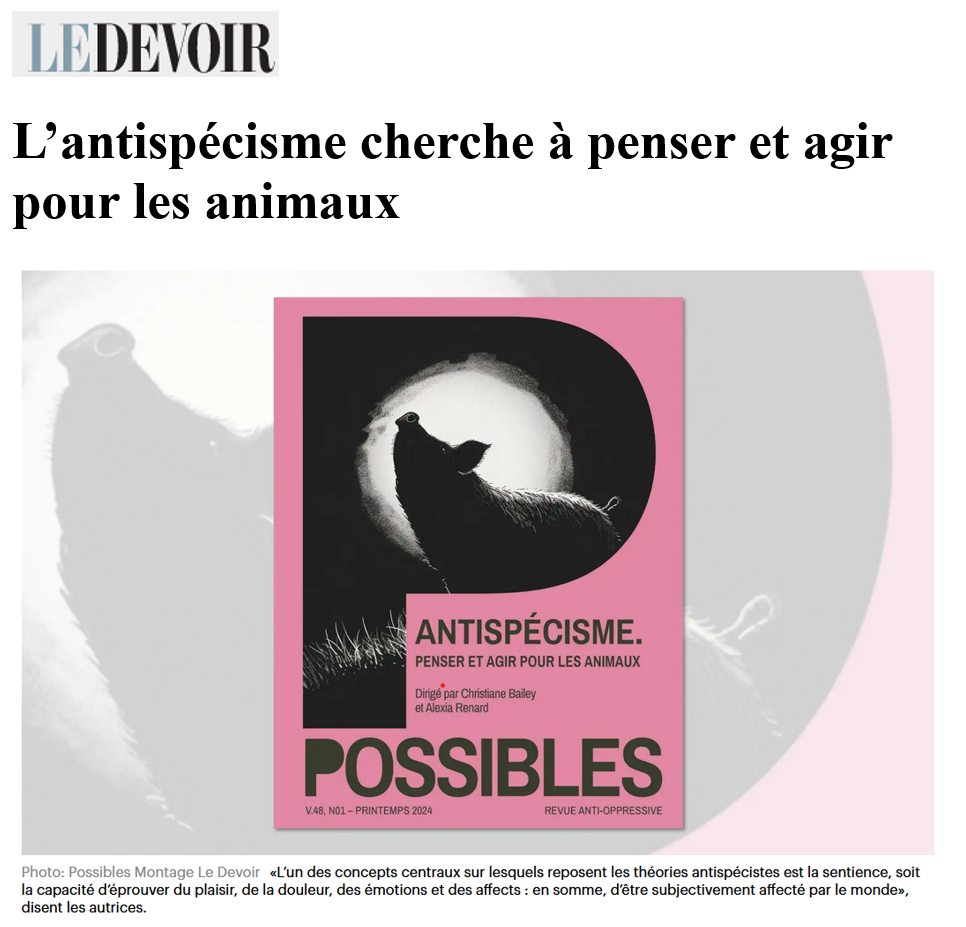notice
Christiane Bailey dans Le Devoir
Le Devoir publie un texte de Christiane Bailey et Alexia Renard sur le dernier numéro de la Revue Possibles sur L'antispécisme et la défense des animaux.
L’antispécisme cherche à penser et agir pour les animaux
Les autrices sont respectivement coordonnatrice du Centre de justice sociale de l’Université Concordia et doctorante en science politique et chargée de cours à l’Université de Montréal.
Il n’est plus rare aujourd’hui de rencontrer des personnes se réclamant ouvertement de l’antispécisme, et bon nombre d’actions militantes en faveur des animaux sont menées en son nom.
Idée philosophique aussi bien que lutte politique, l’antispécisme fait désormais partie du débat public. Pour nombre de citoyens, ce qu’on inflige aux non-humains n’a plus rien de nécessaire ni d’acceptable.
C’est que l’antispécisme s’oppose fondamentalement à une conception anthropocentriste de l’univers qui considère les animaux des autres espèces comme des êtres inférieurs, des choses ou des ressources naturelles à notre disposition. Il s’agit d’une remise en question de la suprématie humaine, selon laquelle les humains sont par essence différents des autres animaux et que cette différence justifie notre domination sur eux.
Certes, le spécisme aussi direct est rarement défendu. Les gens vont plutôt soutenir que ce n’est pas l’appartenance à l’espèce qui sert de critère pour exclure les animaux, mais des capacités que seuls les êtres humains possèdent.
Si les animaux ne comptent pas moralement, c’est parce qu’ils ne sont pas rationnels, pas assez intelligents, pas doués de langage, pas conscients d’eux-mêmes ou encore parce qu’ils n’agissent que par instinct.
Pourtant, ce qu’on appelle les « propres de l’homme » est contestable à la lumière de ce que la science nous apprend des animaux. Chaque jour, on s’étonne un peu plus de leurs capacités insoupçonnées et de la richesse de leur vie psychologique et sociale.
Des êtres sentients
Contrairement à ce que certaines caricatures laissent entendre, l’antispécisme ne nie pas qu’il existe certaines caractéristiques distinctement humaines. En revanche, l’antispécisme rejette l’idée que l’absence de ces capacités justifie l’oppression des animaux.
L’un des concepts centraux sur lesquels reposent les théories antispécistes est la sentience, soit la capacité d’éprouver du plaisir, de la douleur, des émotions et des affects : en somme, d’être subjectivement affecté par le monde.
Dans cette perspective, c’est le simple fait d’être un « soi vulnérable », un individu qui se soucie de ce qui lui arrive, qui devrait compter moralement. Si un individu est sentient, nous devons éviter de lui faire du mal, de le tuer, de porter atteinte à son intégrité physique et psychologique, de le priver de sa liberté — et ce, peu importe son degré d’intelligence, son espèce ou son utilité sociale.
Pourtant, si la loi interdit les traitements cruels envers les animaux, elle ne conteste pas le principe même de l’exploitation des animaux, qui implique de causer des torts immenses à plus de mille milliards d’individus sentients chaque année, si l’on compte les animaux aquatiques.
Penser et agir contre le spécisme
Que pouvons-nous faire pour transformer un tel système, de plus en plus contesté et moralement indéfendable ? Comment repenser nos relations avec les animaux, tant domestiqués que sauvages ?
Ce numéro de la revue Possibles, intitulé « Antispécisme. Penser et agir pour les animaux », propose des pistes de réflexion pour créer un monde affranchi de la domination humaine. Les auteurs réunis pour l’occasion sont philosophes, politologues, militants, avocats, journalistes. Ils réfléchissent à la possibilité d’un monde où la sentience de tous les animaux, y compris celle des poissons, serait prise en compte. Un monde où des espaces de cohabitation interespèces remplaceraient les élevages. Un monde dans lequel les féministes et les animalistes seraient solidaires et dans lequel les algorithmes ne seraient pas spécistes. Un monde où les animaux vivant en ville ne seraient plus considérés comme des nuisibles.
Ce numéro explore également la question de la sexualité animale ; il met en scène des extraterrestres amateurs de chair humaine, revient sur l’histoire de l’animalisme au Québec et celle des actions directes, interroge les accusations d’anthropomorphisme et conteste le mythe de l’humain prédateur. Ensemble, ces textes tissent un fil rouge : interroger, jusque dans des recoins insoupçonnés, ce que signifie lutter contre le spécisme.
L’avenir sera-t-il antispéciste ?
Si l’humanité poursuit sa trajectoire, elle se dirige vers un avenir où il y aura de plus en plus d’animaux domestiqués exploités pour l’alimentation et de moins en moins d’animaux sauvages. C’est un avenir que peu de gens souhaitent. Nous sommes aujourd’hui nombreux à souffrir de voir souffrir les animaux et à aimer les voir heureux, libres et en vie.
La plupart d’entre nous ont du mal à regarder des reportages sur l’industrie de l’élevage et sur les laboratoires. Cette compassion envers les animaux, longtemps rejetée comme de la sensiblerie enfantine, féminine, ou comme une forme d’anthropomorphisme, est de plus en plus acceptée, politiquement, socialement et philosophiquement.
Avec le développement de nos connaissances sur les capacités mentales et sociales des autres animaux, nous ne pouvons plus prétendre croire que nous sommes les seuls êtres conscients sur Terre.
C’est bien cette idée que l’antispécisme nous invite à abandonner.
Texte paru dans Le Devoir du 4 juin 2024.
Les textes sont disponibles en format imprimé ou gratuitement en ligne : Vol. 48 No. 1 (2024): Antispécisme. Penser et agir pour les animaux | Revue Possibles.