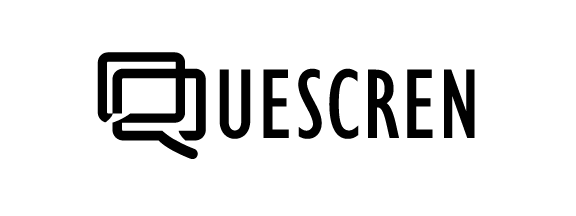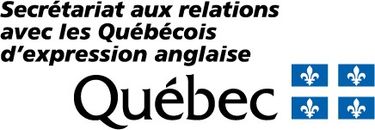médecin-épidémiologiste
Professeure titulaire de clinique, École de santé publique, Université de Montréal;
Médecin, Département de médecine préventive et santé publique, Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)
novembre 2024
Comment décririez-vous le travail de médecin-épidémiologiste à quelqu’un qui ne connaît pas cette spécialité?
L’épidémiologiste cherche à comprendre les déterminants et les causes des maladies qui touchent une population, et travaille à définir des stratégies pour améliorer la santé. Cette personne utilise des méthodes de recherche issues de la médecine, comme des études de cohorte ou des études cas-témoins.
Le médecin épidémiologiste utilise ses connaissances médicales pour étayer ses questions de recherche, qui sont généralement d’ordre médical ou liées à la santé. Son expérience clinique ou médicale lui offre une approche unique, et lui permet d’aborder des questions de recherche en ayant une compréhension plus approfondie des soins aux patients et des résultats en matière de santé.
Qu’est-ce qu’un professeur de clinique? En quoi cette fonction interagit-elle avec votre travail de médecin?
Les médecins travaillent généralement dans des hôpitaux ou des cliniques, mais ils peuvent également être affiliés à des universités, où ils assument souvent des fonctions d’enseignement. S’ils sont rattachés à un hôpital, ils peuvent occuper un poste « clinique » en milieu universitaire et sont alors appelés « professeurs de clinique ». Plutôt que de faire partie des membres principaux du corps professoral, ils sont affiliés à l’université et offrent aux personnes étudiantes une supervision, des possibilités de stages ou toute autre expérience pratique et concrète sur le terrain.
Quel est le lien entre vos recherches et les communautés d’expression anglaise du Québec?
Mes travaux visent actuellement à cerner les sous-groupes d’anglophones du Québec ayant des besoins plus importants, en particulier au sein de groupes socioéconomiquement désavantagés; j’examine leurs expériences du point de vue de la santé, et notamment de la santé maternelle et infantile. Des recherches ont en effet révélé des taux élevés de diabète gestationnel et d’hypertension artérielle pendant la grossesse chez certains groupes anglophones défavorisés du Québec. Nous essayons par conséquent de comprendre ce phénomène.
Pouvez-vous décrire le concept de santé maternelle et infantile, et expliquer pourquoi il est si important?
La grossesse est une période unique durant laquelle les patientes consultent régulièrement un médecin ou un autre membre de la profession médicale, ce qui permet d’améliorer la santé à la fois de la mère et de l’enfant. Outre le fait qu’elle vise à assurer le bon déroulement de la grossesse, cette période peut également mettre au jour des problèmes de santé sous-jacents ayant des conséquences à long terme. Le stress physique causé par la grossesse peut déclencher des problèmes qui non seulement indiquent des risques de santé futurs, mais permettent aussi aux prestataires de soins de santé d’intervenir rapidement.
Par exemple, le diabète gestationnel ne se manifeste que pendant la grossesse et disparaît généralement après l’accouchement. Cependant, il crée un environnement néfaste pour le fœtus et augmente le risque d’apparition d’un diabète plus tard dans la vie.
À quel public vos travaux s’adressent-ils?
La recherche en santé s’adresse à de multiples publics. D’un point de vue politique, les chercheuses et chercheurs peuvent aider les ministères de la Santé à surveiller et à mesurer les indicateurs de santé de la population en analysant les données et en fournissant des statistiques pertinentes. Dans le domaine de la santé maternelle et infantile, par exemple, les indicateurs clés peuvent porter sur le recours aux hôpitaux et les résultats d’accouchements dans différents groupes.
La recherche en santé sert également d’outil de défense des droits, puisque les résultats peuvent contribuer à susciter des changements et à améliorer la santé des populations vulnérables. Nos travaux s’adressent par ailleurs à la communauté universitaire, dans la mesure où nous voulons faire progresser la recherche et inciter d’autres scientifiques à enrichir les connaissances dans le domaine. Enfin, il est essentiel de diffuser nos découvertes auprès du grand public si nous voulons qu’elles aient des retombées significatives.
D’après votre expérience, quels sont les moyens les plus efficaces de sensibiliser le public aux recherches sur la santé?
Faire connaître des résultats de recherche à un public élargi peut être difficile; or, il est essentiel de le faire. Si les chercheuses et chercheurs ne peuvent pas diffuser leurs découvertes, tout le travail accompli pour générer ces résultats s’arrête là, et les autres ne pourront ni les voir ni en bénéficier. Nous faisons de notre mieux pour que nos résultats de recherche soient publiés dans des revues, présentés ou intégrés dans des rapports, mais nous comptons ensuite sur la collaboration d’organismes – comme QUESCREN – dont le mandat est de mobiliser les connaissances, pour nous aider à diffuser l’information auprès des personnes qui s’y intéressent ainsi que pour sensibiliser le public à nos découvertes.